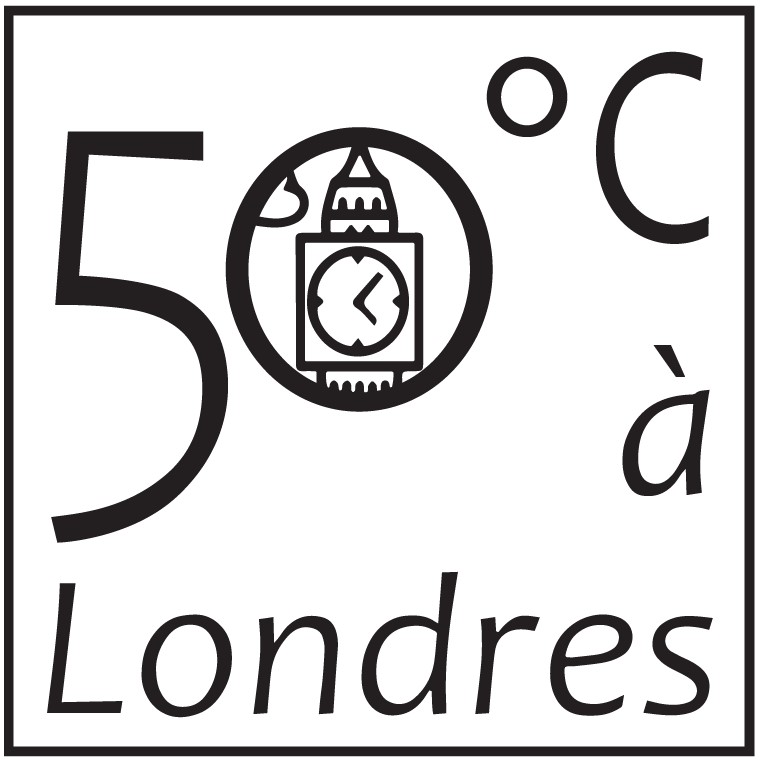Les entreprises actuelles se sont développées dans un contexte où les enjeux environnementaux n’étaient pas aussi visibles qu’aujourd’hui et dans lequel la notion de maximisation du profit a pris le pas sur tout autre considération, augmentant par là-même les externalités négatives pour la société (pollution, impacts sur la santé et les écosystèmes…).
Le modèle d’affaires dominant repose donc sur un modèle économique linéaire, dans lequel la rentabilité a pris la place centrale, et qui est devenu incompatible avec les enjeux de demain (changement climatique, accès à la ressource en eau, hausses des prix, pénuries & tensions d’approvisionnement…).

La problématique in fine n’est pas juste un problème environnemental. Tous les grands enjeux politiques, économiques ou sociaux des prochaines décennies (que l’on parle de commerce, de (géo)-politique, de paix, de sécurité, d’agriculture, de santé, d’immigration, d’industrie….) vont être complètement bousculés et transfigurés par les ruptures à venir.
Car il ne s’agit pas seulement de sortir des énergies fossiles comme on pourrait le croire mais de repenser en profondeur nos modes de consommation, de production et d’organisation de la société. De retrouver des modèles centrés sur la question de l’intérêt et de l’usage du produit ou du service proposé et non pas sur leur rentabilité. Le terrain de jeu social, sociétal, législatif, politique & environnemental va changer drastiquement dans les décennies à venir. Le concept même de liberté va certainement devoir évoluer. C’est pour cela qu’il est nécessaire de se pencher dès à présent sur la redirection et la résilience de ses activités au plus tôt afin de pérenniser son entreprise ou d’assurer la sécurité alimentaire / sociale de son territoire.
C’est un long chemin qui s’annonce mais nous sommes persuadés que les organisations qui se seront emparé le plus tôt de ces questions seront celles qui seront les plus aptes à réussir demain.
Nous proposons de parcourir ce chemin avec les entreprises mais également les collectivités. En effet, comme nous l’avons vu, nous sortons de 200 ans (voire 250 ans pour les régions minières) d’économie fondée sur le développement industriel et l’extraction et la transformation de ressources naturelles. Ces activités ne sont pas neutres d’un point de vue environnemental et social et développent ce que l’on appelle des externalités négatives.
Que sont les externalités négatives ? Elles caractérisent « le fait qu’un agent économique crée, par son activité une nuisance, un dommage sans compensation (coût social, coût écosystémique, pertes de ressources pas, peu, difficilement, lentement ou coûteusement renouvelables…) ».
Si l’externalité négative n’a donc pas de prix pour l’agent économique qui la provoque, elle a un coût collectif pour la société qui la subit. Car où se présentent ces externalités négatives ? Au sein des territoires et des populations qui sont affectées par ces dernières (et qui le plus souvent payent pour leur traitement). Que ce soit pour des problèmes de pollution, des problèmes de mouvement de sols, de nuisances sonores… mais également de problèmes sociaux suite à la fermeture des industries principales d’un territoire (le bassin houiller en étant un exemple). Jusqu’à maintenant, ces externalités étaient considérées comme des contreparties acceptables d’une dynamique économique et d’une attractivité d’un territoire. Cependant, certains signaux faibles montrent qu’il pourrait en être autrement sous peu (regardons notamment les questions de pollution des eaux et des sols aux PFAS).
De plus l’évolution future (environnementale notamment mais également sociale) va certainement affecter en profondeur les territoires. Les besoins vitaux (se nourrir, boire, avoir un toit, avoir accès à l’énergie, se soigner, se sentir en sécurité) risquent d’être plus difficilement remplis à l’avenir suite à la dégradation notre environnement (baisse de la fertilité des sols, changement et aléas climatiques, problèmes d’accès à l’eau douce, pollution des eaux, baisse des ressources naturelles et notamment des énergies fossiles ….). Il a par exemple été démontré par le cabinet UTOPIES que « Le degré d’autonomie alimentaire moyen des 100 premières aires urbaines françaises est (seulement) de 2,1% » c’est-à-dire que « la part du local dans la totalité des produits agricoles incorporés dans les différents produits alimentaires (bruts, élaborés, transformés ou cuisinés) consommés par les ménages locaux reste très marginale. Dit autrement, 98% du contenu des aliments consommés localement sont importés. Et la raison n’est aucunement une carence de production alimentaire sur les territoires en question, puisque dans le même temps, 97% de l’agriculture locale des 100 premières aires urbaines finit dans des produits alimentaires consommés à l’extérieur du territoire… »
Or comment faire au besoin vital de se nourrir quand on anticipe à la fois une baisse des rendements agricoles et une raréfaction des énergies fossiles vitales pour le secteur de l’agro-alimentaire (transport, transformation mais aussi engrais…) ?
Il est donc important que les collectivités s’emparent à la fois de la question de la redirection écologique des entreprises de leur territoire ainsi qu’à la notion de résilience territoriale.